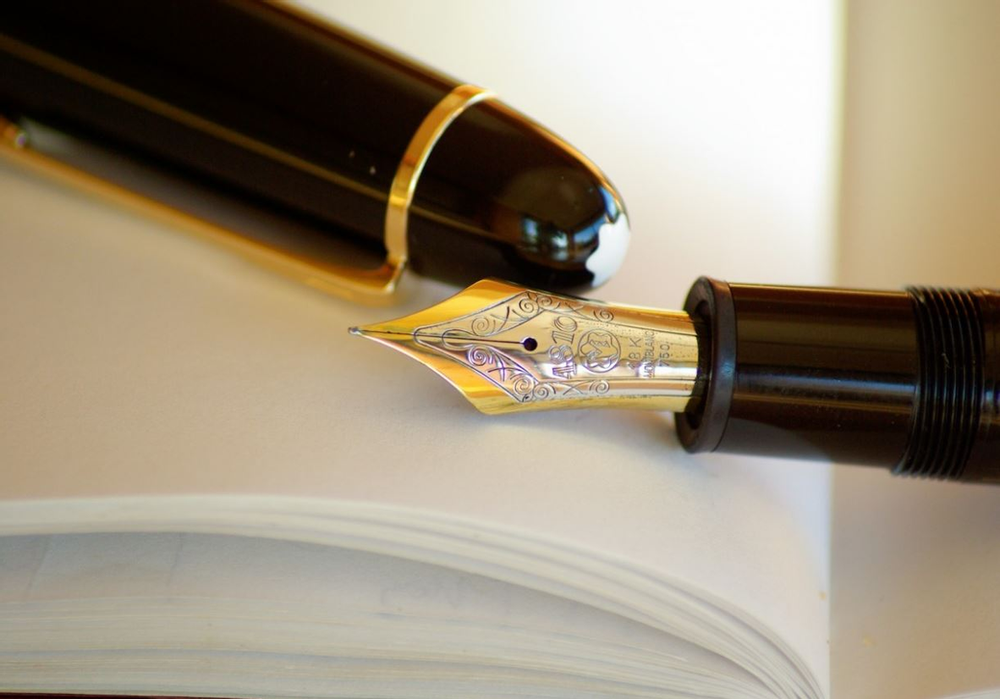Action en partage successoral
En principe les cohéritiers se mettent d’accord sur la forme du partage et sur la distribution entre eux des différents éléments du patrimoine successoral. Mais il arrive qu’un héritier refuse d’y procéder ou que les cohéritiers ne puissent liquider la succession à l’amiable ou conventionnellement, avec pour conséquence que la communauté héréditaire se prolonge. Ainsi l’art. 604 al. 1. CC prévoit chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

1. L’objet de l’action en partage
Il convient de distinguer l’action en partage de l’action tendant au partage. L’objet de la seconde est de faire constater par l’autorité judiciaire la question du principe de partage, c’est-à-dire l’absence de causes d’ajournement de celui-ci. L’action a donc un caractère constatatoire (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1240). Si l’action tendant au partage vise à faire trancher par le juge la question du principe du partage, l’action en partage est destinée à faire prononcer par l’autorité judiciaire le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s’entendent pas sur les modalités de celui-ci, réglées par les art. 610 à 619 CC. Les deux actions peuvent être cumulées dans une seule procédure. Le demandeur doit ainsi réclamer que le juge ordonne le partage et qu’il lui attribue sa part héréditaire. L’action en partage revêt ainsi une nature formatrice (art. 87 CPC ; CR CC II-Spahr, art. 604 N 3 ; ATF 130 III 550 consid. 2.1.1).
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie d’une action en partage, celle-ci doit, notamment, déterminer la masse à partager et fixer la part successorale des parties à la procédure (CR CC II-Spahr, art. 604 N 21).
L’origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit (interprétation d’une règle de partage du de cujus, divergence sur l’estimation d’un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur un droit d’attribution, désaccord sur la répartition des biens entre les héritiers, etc.). Dans le cadre de l’action en partage, l’autorité judiciaire a la possibilité de trancher, à titre préjudiciel ou principal, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions, la validité et l’interprétation d’une disposition pour cause de mort, l’obligation de rapporter, etc (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1283).
1.1 Les conclusions de la demande
Il est dans le devoir du demandeur de prendre les conclusions civiles les plus précises possible, afin que l’autorité judiciaire soit en mesure de rendre un jugement de partage qui puisse être exécuté. Toutefois, le droit de procédure ne peut exiger du demandeur de présenter un projet de partage détaillé. Des conclusions telles que « le partage de la succession est ordonné », sont admissibles, en particulier lorsque le demandeur n’est pas en mesure de prendre des conclusions plus précises, au motif qu’il n’aurait pas toutes les informations nécessaires sur l’état de la succession. Enfin, le demandeur est libre de conclure à l’attribution de tel actif ou de tel passif successoral (CR CC II-Spahr, art. 604 N 26 s).
1.2 Les conclusions de la défense
Les conclusions du défendeur sont dites réciproques et ne sont pas qualifiées de reconventionnelles puisque l’action en partage a cette particularité d’être double « actio duplex », à savoir que chaque héritier au procès est à la fois défendeur et demandeur. Les parties ne poursuivent pas des buts forcément opposés, mais soumettent à l’autorité judiciaire des conclusions différentes sur lesquelles le partage peut être réalisé. Le défendeur ne peut pas ouvrir à son tour une action en partage indépendante, pour cause de litispendance (CR CC II-Spahr, art. 604 N 28 s).
1.3 L’action en partage partiel
L’action peut être limitée au partage partiel quant à la personne du demandeur, par exemple lorsque les défendeurs souhaitent demeurer en indivision (ATF 96 II 325 consid. 6a, JdT 1972 I 72). Le demandeur peut aussi ne requérir qu’un partage partiel quant à l’objet. Mais, dans les deux cas, l’action ne sera restreinte à un partage partiel que si les défendeurs ne demandent pas à leur tour le partage total de la succession (CR CC II-Spahr, art. 604 N 31).
2. La procédure
2.1 La qualité pour agir
La qualité pour agir appartient à chaque cohéritier personnellement ainsi qu’à l’autorité appelée à concourir au partage selon l’art. 609 al. 1 CC, lorsqu’elle n’est pas parvenue à conclure une convention de partage. Plusieurs d’entre eux peuvent agir conjointement, en qualité de consorts simples (art. 71 CPC) (CR CC II-Spahr, art. 604 N 5 ss).
Les légataires, les usufruitiers, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur d’office de la succession, le liquidateur officiel et le représentant selon l’art. 602 al. 3 n’ont pas qualité pour agir. Il en va de même du tiers cessionnaire d’une part héréditaire mais celui-ci peut demander le concours de l’autorité selon l’art. 609 al. 1 CC (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1241a).
2.2 La qualité pour défendre
Le(s) demandeur(s) doivent ouvrir action contre tous les autres cohéritiers. Il y a entre ceux-ci une consorité passive nécessaire au sens de l’art. 70 CPC (CR CC II-Spahr, art. 604 N 9).
2.3 Les conditions de procédure
Le for est celui du dernier domicile du de cujus (art. 28 al. 1 CPC). En cas d’action indépendante relative à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole (art. 28 al. 3 CPC), il y a un for alternatif au lieu où l’objet est situé (CR CC II-Sphar, art. 604 N 11).
S’agissant du délai, l’action est imprescriptible aussi longtemps que dure la communauté héréditaire (TF 5A_546/2009 du 7 mai 2010, consid. 6.2).
Les dispositions du CPC déterminent quelle procédure est applicable. Le litige est tranché en procédure ordinaire ou en procédure simplifiée (art. 219 ss et 243 ss CPC) (CR CC II-Sphar, art. 604 N 14). La procédure sommaire peut être appliquée si les conditions d’un « cas clair » au sens de l’art. 257 CPC sont remplies (CPra Actions-Bonhet, vol. I, § 39 N 10).
2.4 La valeur litigieuse
La valeur litigieuse est représentée par la valeur totale du patrimoine à partager. Il est admissible de s’attacher à la valeur nette du patrimoine, à moins que celle-ci ne soit trop faible pour refléter le travail et la responsabilité engagés par le Tribunal et les mandataires des parties. Le cas échéant, il faudra se référer à la valeur de l’actif brut (CPra Actions-Bonhet, vol. I, § 39 N 11). Dans les autres cas, elle correspond à la valeur de la part réclamée par le demandeur (ATF 127 III 396, consid. 1b/cc, JdT 2002 I 299).
3. Les compétences du juge du partage
Le juge du partage peut trancher toutes les questions qui lui sont soumises. Il a notamment le pouvoir de réaliser certains actifs successoraux (art. 612 al. 2 CC). Il a également le pouvoir d’attribuer directement les actifs et les passifs successoraux aux différents héritiers (CR CC II-Sphar, art. 604 N 34). Selon une partie de la doctrine, à défaut d’accord entre les héritiers, le juge du partage doit former des lots et procéder à leur tirage au sort. Il doit examiner si les conclusions du demandeur sont conformes aux règles de partage prescrites par le défunt et, subsidiairement aux règles de partage spécifiques des art. 612a ss CC et des critères généraux des art. 610 à 612 CC (CR CC II-Sphar, art. 604 N 35 ss). Pour le surplus, le juge du partage dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1285).
4. L’action contentieuse en rapport avec la procédure gracieuse cantonale
Le canton de Fribourg à prévu que la compétence judiciaire gracieuse confiée en la matière au Juge de paix soit distincte de celle du juge contentieux ordinaire. L’art. 14 al. 1 de la loi d’application du code civil du 10 février 2012 prévoit que le juge ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine de la succession, sous réserve de la compétence des notaires. L’art. 14 al. 2 de cette même loi prévoit qu’en dérogation à l’art. 51 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, le ou la juge de paix a compétence dans les cas suivants soumis à la procédure sommaire, à savoir la consignation d’un testament oral (art.507 CC), le dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC) et le sursis au partage et les mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers et des cohéritières d’une personne insolvable (art. 604 al. 2 et 3 CC). Selon Piotet, sauf une disposition cantonale expresse contraire, la compétence du juge du partage absorbe celle du juge civil gracieux (Piotet Denis, L’action en partage en procédure civile, in : Steinauer Paul-Henri / Mooser Michel / Eigenmann Antoine (édit.), Journée de droit successoral 2016, no 34).
5. Conclusions
Bien que l’action en partage puisse paraître assez simple dans la mesure où il suffit de demander le partage, il n’en demeure pas moins que dans les faits, la détermination de la ma masse à partager, respectivement des droits de chacun, n’est pas une mince affaire. L’assistance d’un professionnel rompu à ce domaine du droit sera dans tous les cas un atout précieux pour mener à bien une telle procédure. Nous vous renseignons volontiers.
Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz